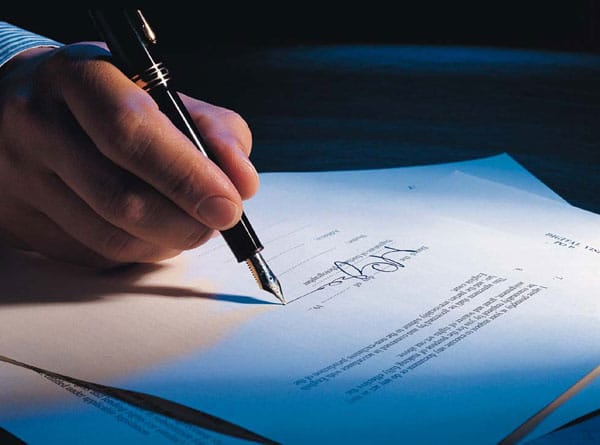Alors que le Code de procédure pénale autorise l’officier de police judiciaire à décider du placement d’une personne en garde à vue lors d’une enquête policière, dès lors qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un délit ou un crime (art. 62 -2 CPP), la loi du 27 mai 2014 a institué une nouvelle mesure policière : l’audition d’un suspect libre.
La profession d'avocat à Cannes, Procédure pénale
La citation directe est un acte d’huissier diligenté par la partie civile
a citation directe est un acte d’huissier diligenté par la partie civile ou le procureur de la République ayant pour effet de faire citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police. Pour les affaires les plus complexes, le procureur de la République engage l’action publique par un réquisitoire introductif d’instance.
Les affaires ne nécessitant pas une instruction (devant le juge d’instruction) seront le plus souvent mises en mouvement par le truchement de la citation directe.
juillet 05, 2022